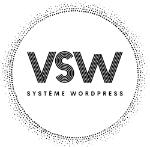On pourrait peut-être se mettre à rêver… Somme toute, si j’avais une baguette magique, quel serait mon plus grand rêve pour la réussite de nos jeunes et adultes en formation? Quelque part, s’il n’y avait pas de résistance au changement, si les dominos s’accordaient tous pour basculer les uns après les autres et favoriser la réussite éducative… Quels espoirs ai-je pour soutenir les élèves et les étudiants dans leur persévérance scolaire et leur réussite sur le plan éducatif?
Pour rappel, les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides ont organisé un panel avec Sandrine Turcotte (psychopédagogue et professeure à l’UQO), Marc-André Carignan (architecte et auteur) et Robert Turbide (psychoéducateur et formateur) et moi. Ils nous avaient soumis quatre grandes questions:
- Quelles sont les actions prioritaires à mettre de l’avant pour s’assurer que nos jeunes réussissent?
- Quelle est la clé du succès pour faire en sorte que nos jeunes puissent accéder à un diplôme qualifiant?
- À la lumière de votre parcours (1ère partie), que recommandez-vous de mettre en place afin de faire une réelle différence dans le parcours scolaire des enfants (2e partie)?
- Si vous aviez une baguette magique, quel serait votre plus grand rêve pour la réussite de nos jeunes et adultes en formation?
Le danger de la question, c’est d’imaginer qu’il faudrait un miracle pour que les choses changent… En fait, il y a moyen de travailler à l’intérieur des structures et de nombreuses écoles (et donc de commissions scolaires) sont déjà inscrites dans une dynamique de transformation. Pourtant, il reste de nombreux pièges.

Lors du mouvement de grève qui avait vu les enseignants francophones belges refuser de retourner en classe, et ce, durant 7 semaines lors de l’année scolaire 1990-91, j’avais eu la chance de participer aux tractations menées par le syndicat auquel j’étais affilié. Mon implication ne consistait pas à négocier, mais à imaginer et à documenter des solutions pragmatiques au sein d’un groupe d’enseignants engagés. Il y en avait de nombreux à travers la Communauté francophone de Belgique. Jeune enseignant, j’y voyais l’occasion de proposer des solutions concrètes à l’intérieur d’une enveloppe budgétaire.
Ce n’étaient pas mes premières armes pour promouvoir et protéger tant les conditions d’accès que les ressources pédagogiques nécessaires. En 1986, le gouvernement belge avait déjà tenté de réduire le financement des écoles. Alors en 5e secondaire, nous nous rendions compte que les premiers qui allaient être touchés par les mesures de restriction budgétaire, c’étaient les élèves en difficulté. À cette époque, certains cours se donnaient par « demi-classe », c’est à dire un maximum de 15 étudiants par classe, ce qui permettait ces élèves de recevoir l’attention nécessaire.
Je n’allais pas touché par cette mesure. J’avais la chance de réussir sans vraiment étudier (excepté les cours de langues). Mais, je trouvais inconcevable que les élèves en difficulté paient le prix des mesures gouvernementales.
J’avais accès à la clé, de part mes implications sociales, de notre Collège. Un samedi matin de la mi-juin, on se réunit dans un local. Nous sommes sept. En quelques heures, on crée une association « Conscience des étudiants« , on écrit un bref manifeste et on se réparti les responsabilités pour sensibiliser nos collègues.
Nous encourageant depuis toujours à nous impliquer, Étienne Florkin, notre directeur, nous faisait confiance. Il accepta de fermer les yeux sur notre absence.
Et c’est une trainée de poudre! Jamais on n’aurait pu imaginer l’ampleur…

En 3 jours, nous irons chercher plus de 7000 signatures auprès de nos collègues étudiants à travers les écoles secondaires de Liège. Nous avions aussi réussi à créer une certaine complicité avec la police: nous leur avions donné des garanties de rester pacifiques, mais nous ne voulions tellement pas que notre mouvement soit récupéré par des irresponsables. Les radios et les chaines de télévision embarquent, touchées par le message humanitaire que nous tentions de dégager dans un débat politique houleux entre partis et syndicats. Et c’est ainsi que nous étions quelques centaines dans les rues durant la journée du mercredi, afin d’aller porter notre manifeste et la pétition aux responsables politiques.
Le jeudi, nous commencions nos examens de fin d’année…
EST-CE QUE LA SOLUTION PEUT VENIR D’EN HAUT?
Je constate que 32 ans plus tard, nous sommes toujours coincés dans les mêmes enjeux financiers, mais aussi les mêmes défis. Et cela ne va pas en s’améliorant. Ni ici, ni ailleurs. En fait, les « machines administratives » sont devenues gigantesques.
De deux choses l’une:
- oui, il est important que les ministères de l’Éducation, à travers le monde, puissent disposer d’un financement adéquat, mais il ne sera pas suffisant si les structures administratives sont tentaculaires, car l’argent n’aboutira pas dans les écoles; une réflexion pour alléger la lourdeur administrative est nécessaire;
- non, il ne faut pas attendre que la pluie tombe du ciel; des mesures gouvernementales sont à espérer, mais il est important que chacun se responsabilise et utilise ses moyens pour s’impliquer concrètement, comme j’ai pu le vivre comme enseignant, comme j’ai pu l’encourager comme consultant dans certaines écoles depuis lors.
Et quand je parle de « chacun se responsabilise », cela implique autant le personnel éducatif que les parents et les étudiants, ainsi que toutes les personnes qui – de près ou de loin – peuvent contribuer à transformer l’École pour qu’elle puisse offrir des moyens concrets à ce que les enfants et les adolescents puissent développer leur potentiel.
En fait, chacun fait sans doute très bien son travail, à chaque niveau… Toutefois, on se rend compte que les rouages coincent. Il faut donc s’élever et regarder comment mettre de l’huile à chaque étape de décision. Et remettre l’être humain au coeur des préoccupations administratives.
L’UNIVERSITÉ FAIT PARTIE DU PROBLÈME
Quand j’ai réalisé mes études pour devenir enseignant, nous avions – 10 mois par année – 32 heures de cours par semaine, dont la moitié concernaient des cours de psychologie de l’enfant (10 heures) et de psychologie appliquée pour développer notre « savoir être » (4 heures). Le reste était assez proche des cours donnés aujourd’hui dans les universités québécoises. Toutefois, la formation belge serait considérée comme « un double bacc », si elle était donnée ici. Toujours est-il que beaucoup de temps était consacré à « comprendre l’enfant dans son développement global, » et ce, bien au delà de la didactique…
Par ailleurs, mais ce n’était pas ainsi dans toutes les instituts, mes profs étaient de vieux briscards, souvent proches de la soixantaine. Et, depuis 35 ans, ils retournaient sur les bancs d’école tous les mercredis matins. C’est à dire qu’ils donnaient cours aux étudiants en enseignement, puis allaient observer les stratégies et leurs effets dans les classes primaires. Autant pour nous offrir un mentorat que pour observer comment les élèves apprivoisaient les apprentissages. Ils se servaient donc des bons coups et des moins bons coups des stagiaires pour ajuster ou réajuster leur propre enseignement en didactique et en pédagogie!
Aujourd’hui, la mode étasunienne privilégiée dans nos universités et les nombreuses administrations publiques encourage la « quantification des effets. » La logique est compréhensible, mais l’application des méthodologies quantitatives isole le « sujet » de l’étude et on perd progressivement le contact avec la complexité de l’être humain. Somme toute, les conclusions de ces études peuvent difficilement tenir compte de l’expérience singulière de l’enfant, de l’adolescent et, même, de l’enseignant.
D’une certaine manière, l faut prouver avec des chiffres que « ma » technique d’apprentissage est meilleure que les autres, comme on le fait d’ailleurs avec les médicaments. Cela dans un monde dans lequel les chercheurs sont évalués sur le nombre de publications. Et, comme pour les médicaments, les études qui ne racontent pas de « belles histoires » ne sont pas publiables dans les revues scientifiques…

Autrement dit, on n’observe pas, on mesure. Et comme il faut – techniquement – contrôler les variables, sauf celle qui est mesurée, on est obligé d’imposer des conditions expérimentales qu’aucune classe ne rencontrera jamais. Bref, il y a un décalage énorme entre la « connaissance universitaire » et l’expérience du terrain:
- cela fait en sorte que les « stratégies pédagogiques » privilégiées peuvent nous confondre (il y a une différence entre la théorie et la réalité), alors que les étudiants universitaires peuvent être bombardés de « connaissances universitaires » qui ne sont pas nécessairement adaptables dans une classe;
- on pourrait craindre également que les contenus des programmes soient trop influencés par les « connaissances universitaires, » ce qui induit également un décalage entre la réalité d’une classe et celle offerte par les théoriciens;
- la recherche quantitative dégage statistiquement « un meilleur, contre les autres, » et ce, même si « les autres » apportent des solutions concrètes pour certains élèves tenus en échec par « la meilleur. »
En marge de ma pratique clinique et de la formation continue que j’anime dans les écoles, je suis aussi chercheur universitaire. Professeur associé au département de psychiatrie de l’université de Sherbrooke, je pilote des projets de recherche, après en avoir réalisé comme étudiant. La recherche est nécessaire. Toutefois, la volonté de quantifier les effets d’une méthode ou d’une pratique est difficile à réaliser:
- d’une part, il faut être vachement orgueilleux pour imaginer que les effets soient juste dus à la technique explorée (l’être humain est influencé par de nombreux facteurs);
- d’autre part, les conditions réelles – et donc la singularité de chaque groupe – peuvent influer sur la qualité des données quantifiées (l’être humain est influencé par de nombreux facteurs).

Il va donc falloir encourager le retour sur les bancs d’école des professeurs universitaires pour qu’ils prennent le temps, et ce, sur une base régulière, d’observer les enfants et les adolescents. Tout en considérant, malgré les défis techniques, le retour à des études phénoménologiques qui associent autant la recherche quantitative que la recherche qualitative.
Si vous voulez explorer un exemple de recherche-action ou mieux comprendre les fondements, avec ses forces et ses défis, des recherches en phénoménologie, je vous invite à consulter notre note de recherche (Monzée, Gravel et Paradis, 2015).
RECENTRER L’ÉCOLE SUR UNE PERSPECTIVE HUMANITAIRE
Dans un précédent texte, je vous rapportais l’origine des écoles publiques, telle qu’imaginée par les philosophes et scientifiques qui ont amené, via Georges Washington, la création des États-Unis: favoriser l’esprit civique. Quelque 80 ans plus tard, le président Lincoln avait déjà frapper un mur pour le financement du réseau, car les « nouveaux notables » voulaient des employés modèles, pas des personnes socialement impliquées. Ils anticipaient déjà l’émergence du syndicalisme et la remise en question de la hiérarchie financière qui s’était dessinée et qui est toujours présente aujourd’hui…
Les écoles semblent, aujourd’hui, trop centrées sur l’apprentissage des mathématiques et des langues. On a beau vouloir faire un peu d’éthique, toucher un peu aux arts, explorer un peu la philosophie, mais c’est souvent présenté comme des « techniques » ou des « choses à retenir. » C’est un peu comme si on avait évacué le sens de l’école et le « savoir être, » pour privilégier le « savoir » et le « savoir faire » sans plus de remise en question de ce qui est appris.
Bien sûr, la logique mathématique, la culture générale et les tâches de mémorisation sont essentielles pour permettre au cerveau de maturer. Même si l’accès aux informations est grandement facilitée par les ressources disponibles sur le web, il n’en reste pas moins qu’il est nécessaire d’user de discernement, alors que les processus d’apprentissage aident à l’optimisation des fonctions du cerveau.

C’est ainsi qu’il faudrait remettre le vivre ensemble, et les moyens de favoriser un profond respect entre les individus, au coeur de la formation scolaire. Oui, les matières sont importantes, mais est-ce que les gens sont plus heureux aujourd’hui qu’il y a 80 ans, alors que le nombre d’années de scolarisation a été presque doublé? Combien de gens ressortent blessés de leur parcours scolaire?
Malgré la Loi contre l’intimidation, les rapports de force sont très fréquents dans les écoles. Et le problème, c’est que pour « régler » ce problème, on en crée un autre: on utilise un rapport de force en stigmatisant l’intimidateur et identifiant clairement la victime. Et les choses ne s’arrangent pas quand les réseaux sociaux prennent le relai. Et quand les parents jouent eux-mêmes aux trolls dans les espaces publics, on s’y perd tous.
Il y a donc un changement majeur à initier quant à l’état d’esprit avec lequel nous entrons en relation avec l’autre. Et je ne propose pas de solutions concrètes, car elles dépendent de l’état d’esprit de chacun. Et nous savons tous ce qui encourage cet état d’esprit: bienveillance, intégrité, responsabilisation et démarche réflexive. Une démarche individuelle qui fera fleurir la transformation du collectif.
VALORISER LES MÉTIERS
Pourquoi attendre 17 ans pour choisir un métier? C’est la question que de nombreux jeunes me posent quand ils ont de la difficulté pour « aller » à l’école. Certains savent déjà ce qu’ils veulent faire et ils aimeraient plus d’autonomie. D’autres sont tellement absorbés par les jeux vidéo qu’ils ne savent pas plus à quoi sert leur vie.
C’est moins présent en Europe qu’au Québec, mais que c’est long pour un jeune d’attendre d’être rendu à la fin de son secondaire pour choisir son métier, surtout si c’est une profession dite manuelle. Bien sûr, certains programmes appelés « Pré-DEP » sont parfois offerts pour les élèves qui décrochent. Mais, le sigle le rappelle: « pré-DEP » veut dire « études réalisées avant le DEP. »
Si vous saviez le nombre de fois que j’ai accompagné, en clinique, de jeunes adolescents qui voudraient commencer à travailler comme plombier, électricien, coiffeuse ou manucure. Je me souviens même d’un jeune formidable qui, à 10 ans, voulait apprendre les métiers de la ferme, plutôt que de passer des heures sur les bancs d’école. Son rêve était tellement présent dans ses propos qu’une enseignante pensait qu’il était autiste!
Ils et elles ne veulent pas attendre 19 ans pour travailler concrètement, dans un monde qui s’est centré sur l’intellectualisation de la vie! Les gens savent lire des livres, mais ne savent pas lire des factures, des contrats ou des états-financiers. Ils savent résoudre des calculs parfois complexes, mais sont incapables de tenir un budget et n’ont aucune idée des coûts de la vie.
Alors, pourquoi ne pas recréer des filières professionnelles dès la 2e année secondaire, dans lesquelles les maths, le français et l’anglais sont offerts comme des ressources pour réaliser un métier avec, progressivement, des journées de stage rémunérés pour s’assurer d’un encadrement optimal et sécuritaire?
Pour ce faire, il faut que l’état d’esprit de respect des uns et des autres soit présent dans les écoles et la société, alors qu’on puisse également revaloriser chaque métier. Et permettre autant aux filles qu’aux garçons, qu’aux garçons qu’aux filles, l’accès à toutes les filières professionnelles!
Et s’il se rend compte à 22 ou 30 ans qu’il s’est trompé? Et bien, il y a déjà des embryons de filières et des passerelles qui permettent de revenir aux études et de se réorienter au besoin quand la personne est prête.
RESPECTER LE RYTHME D’APPRENTISSAGE
Comme exprimé précédemment, il est important de quitter le discours médical, pour rendre ses lettres de noblesse aux évaluations pédagogiques qui ciblent les problèmes en fonction du contexte d’apprentissage et pas juste en fonction de symptômes inclusifs. En décembre 2018, l’Institut des statistiques du Québec (ISQ) a publié une étude basée sur 62000 participants. Selon cette étude, 23% de jeunes ont reçu un diagnostic de TDAH (majoritairement des garçons) et 17% d’anxiété généralisée (majoritairement des filles).
Cela surprend, car les chiffres officiellement publiés ont toujours été moindre, à cause des enjeux particuliers des uns et des autres. Pourtant, je vous garantis que ces chiffres sont cohérents avec ceux que les directions d’école et de commissions scolaires me partagent allègrement depuis 10 ans… Notre jeunesse ne va pas bien.
Et cela ne va pas en s’arrangeant, car il y a une multitude de stresseurs qui affectent la réussite scolaire.
Ce qui est sûr, c’est que nous devrions recentrer les apprentissages scolaires sur des méthodes pédagogiques qui respectent le rythme de leur apprentissage: le modulaire, le co-enseignement, les classes moins nombreuses, etc.
Toutefois, cela ne veut pas dire qu’on doit tomber pour la cause dans la complaisance et l’infantilisation. On peut rester exigent. Mais, cette manière de mobiliser le jeune ne peut se faire que si, nous-mêmes, nous sommes exigeants envers nous-mêmes! Et là, on revient aux quatre valeurs qui, selon moi, doit imprégner toutes les interventions.
ALLER PLUS LOIN
Visitez la page ‘psychologie et neurosciences‘ et accédez à ces formations en ligne gratuites:
- Initiation à la neuroéducation;
- Comment soutenir un jeune affecté par l’anxiété?
Des livres pour vous inspirer:
- J. Monzée, Neurosciences et psychothérapie, Montréal, Eds Liber, 2009.
- J. Monzée, Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l’enfant, Montréal, Eds Liber, 2014.
- J. Monzée, J’ai juste besoin d’être compris, Québec, Eds. Le Dauphin Blanc, 2015 (2e édition en 2020).
- J. Monzée, J’ai juste besoin de votre attention, Québec, Eds. Le Dauphin Blanc, 2016.