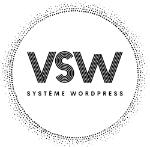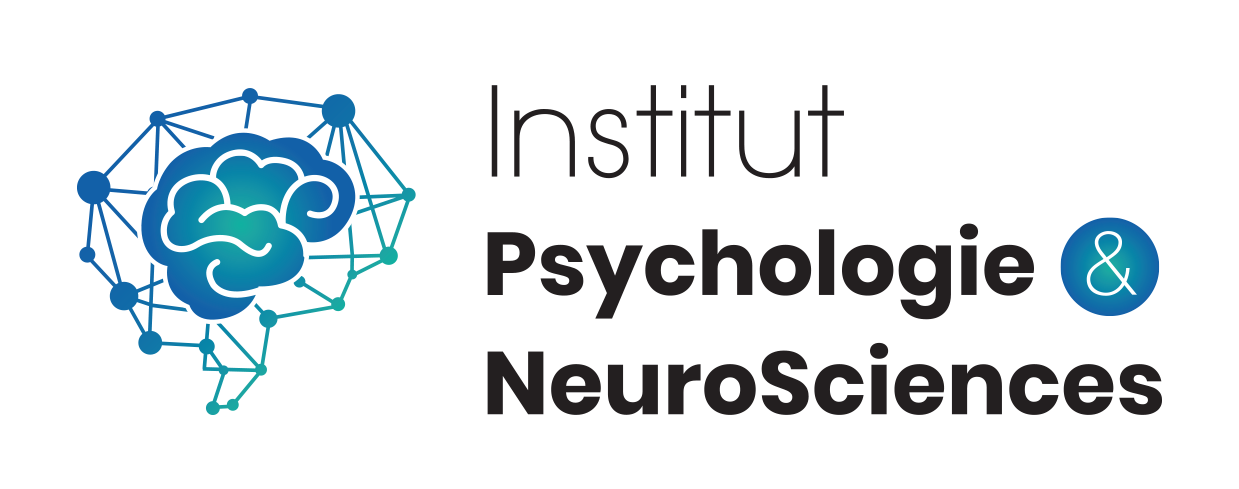Précédemment, j’ai exploré quelques limites des diagnostics psychiatriques, notamment en ce qui concerne le trouble déficitaire de l’attention (TDAH) et la dépression. Et, prochainement, j’aborderai le syndrome d’Asperger. Si vous avez lu ces textes, vous avez constaté que la psychiatrie est une science clinique, basée sur le jugement humain et donc affectée par les théories dominantes. Force est de constater que, ces dernières années, il y a eu deux réflexes qui peuvent induire en erreur l’évaluateur, car il fonctionne en circuit fermé (c’est à dire qu’il n’y a pas de remise en contexte des symptômes):
- la prescription de psychotropes dès que certains symptômes sont observés; si le médicament fonctionne, donc la maladie était bien présente; si le médicament ne fonctionne pas, c’est qu’on a pas trouvé la bonne molécule;
- le recours à des tests psychométriques, proposés par les universitaires pour quantifier la fréquence de certains indices de la maladie, permettrait d’évaluer l’intensité d’un trouble mental, car l’individu est atteint d’un trouble souvent considéré comme d’origine génétique (donc imperméable aux choix et à l’environnement) ou dû à l’absorption de substances.

Les quatre précédents textes explorent explorent quelques limites des tests psychométriques utilisés pour diagnostiquer les troubles psychiatriques. Encore une fois, l’intention n’est pas de critiquer une profession, mais d’apporter des éléments de nuances – certainement incomplets – en regard d’une pratique qui se répand beaucoup en Amérique du Nord.
Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas qu’au coeur de cette réflexion, il s’agit surtout de faire attention pour s’assurer que l’outil serve la personne en difficulté! L’idée, c’est de s’assurer qu’un éventuel diagnostic et qu’une probable direction thérapeutique soient déterminés sans créer une nuisance – certainement involontaire – pour la personne évaluée, diagnostiquée et médicamentée.
Même si les questions sèment un doute sur l’usage des tests psychométriques tels que réalisés actuellement, il ne faut pas oublier que de nombreux spécialistes, comme le pédiatre Guy Falardeau (pédiatre, il a introduit le concept de TDAH au Québec il y a plus de 30 ans) ou Keith Conners (créateur du test psychométrique le plus utilisé pour évaluer l’éventuelle présence d’un TDAH) ont dénoncé maintes fois la sur-utilisation abusive et le manque de rigueur dans la passation des tests psychométriques.
En effet, ce n’est pas parce qu’un test (ou une batterie de tests) donne certaines informations pertinentes que l’analyse de celles-ci est adéquate en regard des besoins de la personne évaluée, puisque chaque test a des limites bien identifiées, mais peu partagées au public. Qui plus est, l’encouragement à la prise de médicaments comme outil d’intervention en conclusion de l’évaluation a de quoi être questionnée également compte-tenu des limites techniques et scientifiques de l’outil en question. Je m’explique.
LES TESTS PSYCHOMÉTRIQUES MESURENT L’EFFICIENCE DES COMPORTEMENTS
Quand on chronomètre le temps au tour de plusieurs Formule 1, on peut évaluer la performance des pilotes, mais que sait-on de l’efficience du moteur, de l’aérodynamique, de l’impact des vents, des réglages spécifiques, de l’émotivité ou des capacités du pilote? On a juste un temps au tour. Sans analyse poussée, il est impossible de comprendre pourquoi un pilote va plus vite qu’un autre, surtout s’ils disposent de montures différentes. Le temps au tour ne nous informe que du temps au tour.
Ce que l’on appelle au Québec des tests en neuropsychologie ne sont, en fait, que de la psychométrie. Ils mesurent des traits comportementaux qu’un neuropsychologue va analyser, alors que ses conclusions sont inscrites dans un rapport, mais le contexte d’évaluation est complètement évacué de l’analyse. Parfois, le clinicien indiquera de la fatigue, mais cela ne remet pas en question la lecture des résultats. Que du contraire.
Précédemment, je vous mentionnait le test psychométrique MPO que j’ai découvert il y a quelques semaines. De tels tests sont très utiles pour évaluer un candidat potentiel à un poste de direction dans une entreprise, afin de s’assurer qu’il ait les ressources nécessaires pour remplir les fonctions du poste ciblé.
Ces tests sont précieux pour déterminer si une personne peut, après un accident, reprendre le volant. Si, par exemple, la personne souffre d’une forme de négligence neurologique partielle, l’évaluation de ses habiletés perceptuelles est importante pour réduire le risque de danger pour elle et pour autrui.
Ils sont également utiles pour mesurer le QI d’une personne, soit pour lui permettre de sauter une année en cas de douance cognitive, soit lui accorder les aides pédagogiques ou sociales nécessaires pour pallier certaines déficiences.
Pourtant, la douance ne touche pas uniquement les aspects cognitifs. C’est ainsi qu’un enfant doué pour les arts ne ressortira sans doute pas gagnant d’une passation des tests pourtant bien utiles pour d’autres jeunes. Il pourrait même se retrouver avec une autre pathologie qui découle d’un manque d’intérêt pour les math car, ne pouvant quitter la classe, il s’échappe « plus que la normale » au pays des muses littéraires ou musicales…

En fait, il y a quatre questionnements majeurs en ce qui concerne des tests spécifiques pour identifier les composantes de troubles psychologiques, surtout ceux utiliser pour identifier le TDAH. C’est peut-être un peu technique, mais cela va permettre de mieux comprendre le discernement nécessaire pour établir la pertinence d’une évaluation psychométrique.
PREMIER QUESTIONNEMENT, EST-CE QU’IL Y A UN LIEN DIRECT ENTRE LE SYMPTÔME ET UNE ZONE PRÉCISE DANS LE CERVEAU?
Premièrement, les tests comme ceux utilisés pour évaluer le TDAH sont mis au point pour déterminer la fréquence de symptômes et permettre le dépistage d’un trouble psychiatrique. Si la fréquence est élevée, la conclusion risque d’aller vers un diagnostic, voire une médication.
Toutefois, ces tests ne tiennent pas compte du contexte de vie de la personne ou des aspects hétérogènes de l’être humain en termes de forces et de défis. Comme si elle était isolée dans un bocal, la personne est évaluée comme si son environnement personnel, professionnel ou scolaire n’avait aucune part de responsabilité.
D’une manière plus embêtante sur le plan de l’éthique, certains experts – partis en mission ou un peu trop proches des compagnies pharmaceutiques – affirment que le trouble détecté est un « désordre neurologique d’origine génétique », ce qui – encore une fois – isole la personne-porteuse des symptômes de son environnement. Je reviendrai sur cette problématique très prochainement, car cette théorie sème beaucoup de confusion, tant chez les médecins que le grand public.
Quant aux campagnes publicitaires, je vous renverrais aux livres L’envers de la pilule et Tous fous? de Jean-Claude St-Onge qui explique notamment les stratégies marketing pour vendre un médicament: les pseudo-associations de malades, la promiscuité avec les laboratoires universitaires, le financement de certains chercheurs médiatisés, les focus groupe pour trouver les mots qui séduiront le public, etc. L’idée qu’il défend, c’est de comprendre que la maladie mentale, c’est un marché très lucratif pour certaines entreprises et cliniques et que celles-ci n’agissent pas toujours avec la noblesse d’esprit que le grand-public serait en droit d’espérer pour confier leur destinée ou celle de leurs enfants.
Et qu’en disent les neurosciences du lien direct entre un symptôme x et une maladie y? Ce lien direct, c’est l’autorisation de prescrire un médicament dans l’espoir qu’il corrigera un dysfonctionnement momentané ou chronique. Prenons les deux maladies mentales les plus courantes en ce moment: le TDA-TDAH et la dépression.
D’une part, le neuropsychologue Jean-Philippe Vaillancourt a fait une recension des études en imagerie cérébrale qui montre que les symptômes associés au TDAH peuvent avoir de multiples origines neurologiques. Le lien direct entre les symptômes et la maladie est dès lors questionnable. Il démontre ainsi que les sources neurologiques du TDAH sont bien plus nombreuses qu’on ne le dit généralement.
D’autre part, Suzane Renaud, médecin au Douglas Hospital de Montréal, fait la même démonstration, dans un chapitre du collectif Neurosciences et psychothérapie, en regard des symptômes de la dépression. Elle conseille d’ailleurs d’affiner les questions lors d’un échange avec le psychothérapeute ou, mieux, passer un examen utilisant l’imagerie fonctionnelle du cerveau.
Et dans les deux cas, on ne parle même pas des aspects hormonaux qui, parfois, peuvent induire les mêmes symptomatologies! Par exemples, un enfant qui vit un choc glycémique à cause d’un diabète non-diagnostiqué, d’un prédiabète, d’un repas trop sucré, etc., peut avoir des symptômes similaires au TDA ou TDAH, alors qu’une personne ayant une thyroïde en déséquilibre peut avoir des symptômes proches de ceux qui sont associés à la dépression. Est-ce une maladie mentale? Ou une condition médicale qui donne l’illusion d’un trouble psychiatrique?
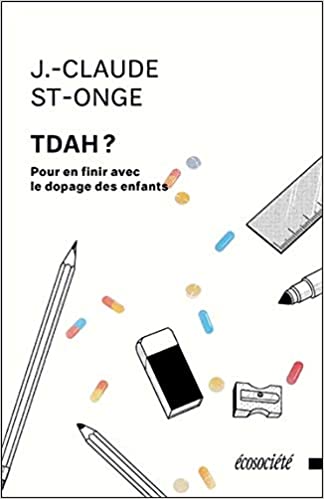
Est-ce que cette réalité des multiples zones n’expliquerait pas le tâtonnement quand on tente de normaliser les comportements avec une molécule chimique? Le médecin ne pourrait-il pas questionner la pertinence ou la validité du « diagnostic » plutôt que de tenter 4-5 molécules ou de monter les doses jusqu’à ce que la personne soit amorphe?
DEUXIÈME QUESTIONNEMENT, EST-CE VRAIMENT UNE MALADIE MENTALE?
Pour rappel, un test psychométrique comme le MPO ne dit pas que cela est bien ou mal. Il constate qu’une personne aura plus de facilité à faire ceci ou cela, que de faire telle ou telle tâche. À l’employeur de choisir de la recruter ou non et, si elle est recrutée, de lui confier des mandats qui répondent à ses habiletés professionnelles. Ce n’est pas le cas des tests qui évaluent les risques de maladie mentale.
On poursuit donc notre réflexion par un questionnement sur l’association entre un symptôme et une maladie mentale. Attention, cela ne veut pas dire que la personne n’a pas besoin d’aide, quelle que soit la réponse. La détresse et le besoin d’un accompagnement sont réels. Il y a besoin d’une intervention éducative ou thérapeutique, et ce, tant et aussi longtemps que la personne exprime de la détresse. Toutefois, il faut faire attention à la nature du symptôme.
Prenons, par exemple, une des composantes majeures du TDAH: l’impulsivité. Il est curieux de constater qu’en ne tenant pas compte du contexte, on pourrait se tromper de direction d’intervention. C’est ainsi que l’impulsivité peut être très utile en sport ou à la chasse, mais déranger en classe. Et encore, on chronomètre la vitesse de lecture des élèves ou on leur demande de remplir un examen dans un temps impartis. Leur impulsivité peut les aider comme leur nuire.
Le problème n’est probablement pas un « désordre neurologique d’origine génétique » mais, plutôt, le contexte dans lequel le comportement est utilisé: il faut donc aider l’enfant à user de plus de discernement. Pour d’autres enfants, ce serait, mettons, une mauvaise canalisation d’une ressource: là encore, on est dans un apprentissage à contenir et, éventuellement, accepter le délai entre la pulsion et l’action. Ce n’est pas de la maladie mentale.

Enfin, il y a les réalités humaines alors que, pour certains enfants, la longueur d’une activité scolaire, le manque d’intérêt, le besoin de concret, la nécessité de l’interaction (quitte à avoir de l’attention négative), etc., sont trop demandantes sur le plan affectif.
Pour d’autres enfants, ils se sentent mal, ne savent pas comment se dire et n’ont pas encore suffisamment de ressources pour gérer leur vie déjà bousculée parce que papa et maman se disputent, parce que grand-maman est décédée et qu’elle manque tellement, parce que il a vécu de l’intimidation et qu’il voudrait échapper au cadre de l’école, parce qu’un adulte a fait une blague, qu’il ne l’a pas comprise, alors qu’il réagit à ce qu’il perçoit comme menaçant, parce que maman a vécu un drame pendant la grossesse et qu’il porte encore les « stigmates » de son vécu intrautérin, etc.
Je ne crois pas qu’un seul test psychométrique tienne compte de ces réalités humaines… Alors, peut-on se tromper de cible quand on n’envisage pas ces expériences de vie plus fréquentes que les experts ne veulent l’envisager?
Bien sûr, les réactions peuvent être dérangeantes, mais est-ce qu’on répond aux besoins de la personne diagnostiquée en lui collant l’odieux d’un manque de tolérance de son environnement? Est-ce une maladie mentale que de ne pas rencontrer les attentes d’autrui?
La vie humaine est tellement plus large et plus profonde qu’une grille d’évaluation de la normalité établie par une équipe de chercheurs universitaires! Qui plus est si la recherche qui a mené à créer cette grille est soutenue par une entreprise pharmaceutique ou une association de personnes malades.
Vous êtes-vous déjà demandé quel est l’impact sur la vie de la personne porteuse des symptômes de se faire « catégoriser » comme atteint par une maladie neurologique d’origine génétique? Peut-être que parfois, c’est une maladie mentale. Mais, est-ce toujours une maladie mentale? Et, encore, est-ce seulement une maladie ou une ressource comportementale mal utilisée ou mal canalisée? Qui détermine que c’est bien ou mal? Les universitaires? Les compagnies pharmaceutiques?
TROISIÈME QUESTIONNEMENT, EST-CE QUE LES CONDITIONS DE LA VALIDITÉ D’UN TEST SONT REPRODUITES EN CLINIQUE?
Ce questionnement est un peu plus technique, je vous en présente mes excuses. En fait, il s’agit de vérifier si les conditions qui assuraient la validité en laboratoire sont reproduites lors de la passation. Dans la majeure partie des situations qui m’ont été rapportées, ce n’est pas possible.
D’une part, nous avons utilisé des tests psychométriques lors d’une recherche sur l’impact d’une mesure d’aide au développement d’enfants scolarisés. Puis, nous avons posé des questions à plusieurs adultes qui ont accepté de contribuer bénévolement à l’étude. Il ressort que les parents et les enseignants remplissent le formulaire d’évaluation qu’on leur remet sur l’idée qu’ils ont de l’enfant ou de l’ado et pas ce qu’ils voient. Est-ce que leurs idées sont justes ou pourraient-elles être influencées par leur agacement ou leur irritation face à un jeune qui résiste à leurs interventions?
D’autre part, les règles de la recherche requièrent des pratiques bien établies et reconnues par la communauté scientifique. C’est ainsi que, pour valider l’efficacité d’un test neuropsychologique, il faut plusieurs conditions scientifiques, dont trois sont essentielles:
- un trio de chercheurs doit analyser de la même manière le comportement du sujet observé; s’il n’y a qu’un seul observateur, le risque de biais est trop élevé, l’analyse du comportement risque d’être influencée par les motivations personnelles de l’observateur;
- on peut comparer deux groupes (l’un utilise un test standard; l’autre, le nouveau test) ou les mêmes sujets par rapport à eux-mêmes (ils passent tous les deux les tests); ainsi, un maximum de deux tests sont utilisés, alors que l’évaluation neuropsychologique devrait durer un maximum d’une heure;
- il faut que les statistiques soient marquantes, donc on sélectionne les patients ayant les symptômes les plus graves pour s’assurer que l’étude soit publiée et que le test mis au point soit adopté par les cliniques…
Tous les articles et thèses scientifiques font états de leurs limites spécifiques. Mais, ces limites ne sont pas expliquées au public, ni aux milieu scolaire qui, de bonne foi, encourage la passation de ces tests pour établir les besoins pédagogiques. Éventuellement, les professionnels de la santé le savent, mais pourrions-nous craindre que, un peu comme les effets secondaires des médicaments pour un médecin, certains évaluateurs puissent minimiser les limites pour ne pas nuire à leur profession?

Par ailleurs, il est fréquent que les enseignants et les parents qui remplissent des grilles le font sur l’idée qu’ils ont de l’enfant et pas la réalité du moment présent. Et que dire de leur compréhension du « plus que la normale » quand on sait que celle-ci est influencée par de nombreux aspects émotionnels, cognitifs, sociaux, idéaux déchus, etc. Normalement, les psychologues-cliniciens sont entraînés à faire ce discernement nécessaire, mais le public ne l’est pas.
QUATRIÈME QUESTIONNEMENT, LES LIMITES DES TESTS SONT-ELLES EXPLIQUÉES AUX PATIENTS, AUX PARENTS DE JEUNES PATIENTS OU AUX ÉQUIPES SCOLAIRES?
Dans un chapitre de mon livre « Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l’enfant« , j’explore les diagnostics à la mode en termes d’augmentation phénoménale du nombre de cas durant ces 20 dernières années. Somme toute, il s’agit de faire attention au sens des symptômes, plus que d’en établir la fréquence.
Le drame, c’est qu’on isole une personne en la pensant « handicapée » dans un monde où règne beaucoup de détresse, de déni, de volonté de sauver, de déresponsabilisation,… Un monde bizarre dans lequel les enfants et les ados doivent apprendre à se fondre. Un psychiatre européen – dont j’ai malheureusement oublié le nom – s’exprima un jour avec une question qui ressemblerait à « est-ce une preuve de santé quand un enfant s’adapte à un environnement dysfonctionnel? »
Pour aborder les limites des tests psychométriques utilisé dans le domaine de la santé mentale, nous allons ainsi présenter série de questions pour vous permettre de développer votre sens critique, essence de l’autonomie affective…
- Dans quelle langue l’édition finale du test a-t-il été publié?
- Se pourrait-il que la traduction (souvent anglais vers français) induise des biais d’interprétation des mots?
- Se pourrait-il que des différences socio-culturelles et éducatives influencent les résultats?
- Combien de personnes observent réellement le patient lors de la passation du test?
- Si l’observateur est seul, est-ce encore valide?
- Combien de personnes utilisent l’idée qu’ils ont d’un patient comme base de leurs réponses à un test passé à la maison ou à l’école?
- Si un observateur très lié au patient est constamment dérangé, voire irrité, par ce dernier, est-ce que son jugement est impartial?
- Combien de tests sont effectués la même journée ou durant 2 demi-journées?
- Quels sont les effets liés à la fatigue physique et mentale?
- Quels sont les effets de contamination du test-1 sur le test-2 (le fait de passer le premier test modifie les réponses du deuxième), des tests-1&2 sur le test-3, des tests-1&2&3 sur le test-4, des tests-1&2&3&4 sur le test-5, etc.?
- Quand s’assure-t-on de l’affordance des tests?
- A-t-on tenu compte de l’intérêt et de la motivation du patient face à une série de tests mis au point par des intellectuels universitaires?
- La personne évaluée est-elle affectivement disponible pour remplir cette série de tests?
- Est-elle contrainte et, potentiellement, en réaction contre l’évaluateur, la personne qui l’impose ou le test en lui-même?
- Quel est l’âge de la personne qui passe le test?
- Est-elle un adulte de plus de 40 ans qui a subi un ACV ou un trauma crânien (dans ce cas, la lésion est réelle)?
- Est-ce un enfant qui vit des défis dans son quotidien (dans ce cas, le défi peut être temporaire et demander simplement de l’aide pour assurer un développement affectif sain et serein)?
- Quel est l’influence de l’environnement familial, scolaire et social?
- Est-ce que la génétique induit nécessairement un trouble ou des mécanismes de défense qui dérangent?
- Est-ce que l’entourage peut faire partie du problème?

ÉVITER LES BIAIS ET NUANCER LES CONCLUSIONS
Vous devez savoir que j’ai posé certaines de ces questions auprès d’amis neuropsychologues. Acceptant de jouer le jeu, ils ont également questionné quelques-uns de leurs collègues et ils me sont revenus, ce qui m’a permis d’affiner les questions. « On sait que cela existe, on essaie de minimiser les effets, mais c’est impossible de tout contrôler« . C’est normal. L’analyse post-passation est donc primordiale pour nuancer les résultats.
Toutefois, quelles sont les croyances, comme on en parlait plus haut, du clinicien qui analyse les données? Est-il en conflit d’intérêts? Est-il satisfait du rythme de développement de sa clinique? Rêve-t-il du pouvoir de prescrire les psychotropes comme un médecin?
Malheureusement, les limites de ces tests font en sorte que, si on n’y prend garde, ils peuvent induire une mauvaise direction d’intervention éducative ou thérapeutique, voire le recours aux psychotropes sans que ceux-ci ne soient réellement justifiés.
Les « experts » ne sont pas immunisés contre ces biais, car certains traits – on l’a vu avec le TDAH et la dépression – sont trop inclusifs. Sans compter que les parents et les enseignants utilisent leur idée de l’enfant et pas nécessairement la réalité pour remplir un questionnaire.
Dans de tels cas, l’enfant ou l’ado est perdant. Il est condamné sans qu’on ne se soit interroger sur le sens de ses comportements, sur le sens de sa souffrance. Je trouve cela non seulement déplorable pour le jeune, mais je m’interroge sur le sens humanitaire de notre société. Quelle société sommes-nous en train de construire?
DES MOYENS POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BIAIS
Alors, avant de dépenser des milliers de dollars pour une telle évaluation, assurez-vous que les meilleures conditions possibles soient au rendez-vous:
- demandez-vous si elle est essentielle, car une école n’a normalement pas besoin d’une telle évaluation pour accorder des accommodements pédagogiques;
- faites-là en vous assurant que votre enfant soit reposé et qu’il ait créé un lien sécurisant avec le neuropsychologue pour éviter que son détecteur de danger ne soit trop alerté;
- morcelez le plus possible la passation des tests pour éviter de faire plusieurs tests la même journée (c’est plus complexe sur le plan logistique, mais vous vous assurez de minimiser les biais techniques);
- identifiez tous les éléments qui pourraient expliquer « autrement » les comportements de la personne évaluée!
Une clinique montréalaise, par exemple, requiert jusqu’à 10 jours différents pour éviter les biais et s’assurer de bien rencontrer les forces de l’enfant ou de l’ado. Je crois que c’est essentiel pour limiter les effets de la fatigue et la contamination entre les épreuves. Je crois que d’aller dans des cliniques qui ont une vision globale est également importante (comportement, nutrition, sommeil, capacités visuelles et auditives, etc.). Enfin, il me semble très important de (1) regarder l’ensemble des éléments affectant la vie de l’enfant et (2) faire des mises en situation impliquant tantôt l’enfant avec le thérapeute et tantôt avec l’ensemble de la famille. Ces éléments permettront de nuancer les conclusions.
Cela dit… Oui, il est important de dépister les personnes en détresse ou celles qui risquent de se tromper de route. Par contre, il est grand temps qu’on reconnaissent la diversité des êtres et qu’on s’ouvre à nouveau vers une complémentarité des ressources humaines, plutôt que de vouloir utiliser des psychotropes pour normaliser des comportements qui ne sont pas nécessairement des troubles, mais peut-être des forces mal-canalisées!
Et cela, c’est un enjeux d’éducation. Un enjeux social et sociétal. Pas une maladie mentale. Du moins, chez l’enfant et l’adolescent.
ALLER PLUS LOIN
- Dennis Charney & Eric Nestler, Neurobiology of mental illness, Oxford UP, 2004.
- Joël Monzée, Médicaments et performance humaine, Éditions Liber, juin 2010.
- Joël Monzée (dir), Neurosciences et psychothérapie, Éditions Liber, 2009.
- Joël Monzée (dir), Ce que le cerveau a dans la tête (Neurosciences et psychothérapie II), Éditions Liber, 2011.
- Joël Monzée (dir), Neurosciences, psychothérapie et développement affectif des enfants, Éditions Liber, 2014.
- Joël Monzée (dir.), Dire OUI à la vie!, Éditions du Dauphin Blanc, avril 2013.
- Joël Monzée, Et si on les laissait vivre, Éditions Le Dauphin Blanc, 2018.
- PsychoDynamic Diagnostic Manual, 2006.
- Jean-Philippe Vaillancourt, L’origine neurologique du TDAH: fait ou hypothèse, RQP, 2012.