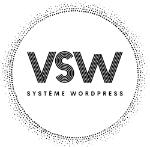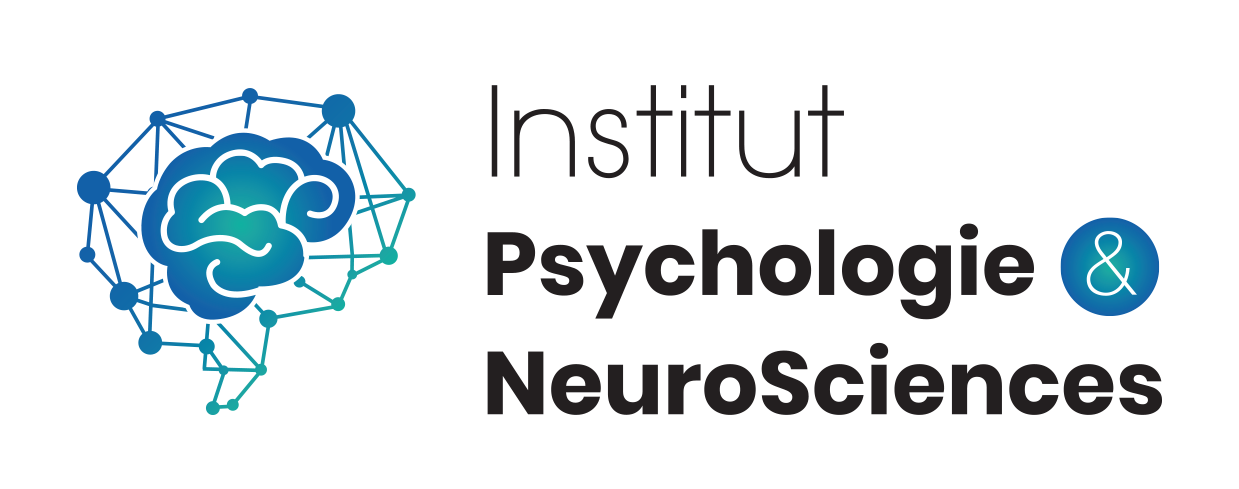Saviez-vous que l’origine du Syndrome d’Asperger n’a rien à voir avec le trouble du spectre de l’autisme? En effet, l’étiquette a été créée par des chercheurs universitaires allemands et autrichiens – dont un certain Hans Asperger – qui, ne constatant aucune ressemblance avec les individus composant la population au sens large, ont voulu expliquer leur réalité sociale à travers une série de comportements.
Depuis, et pendant des années jusqu’à récemment, le syndrome d’Asperger a été considéré – pour le meilleur, comme pour le pire – comme une des affections psychiatriques contenues dans le trouble du spectre de l’autisme. Comme on le verra dans le second texte, cela a généré beaucoup d’erreur de jugement, non pas chez l’individu, mais au sein de la population. Avant d’aller le lire, je vous suggère de vous familiariser avec le concept de neurodiversité.
LA VALSE DES ÉTIQUETTES
La neurodiversité est une richesse humaine. Il est temps de revisiter nos conceptions de l’être humain. Ce sera d’ailleurs le thème d’un colloque qui se déroulera le 30 septembre 2018. Cette journée de sensibilisation sera animée par quatre conférenciers, dont l’australienne Judy Singer (fondatrice du mouvement de sensibilisation à la neurodiversité) et le psychiatre québécois Laurent Mottron. L’un comme l’autre tirent la sonnette d’alarme quant à l’élargissement des critères de l’autisme et la fermeture d’esprit des personnes qui utilisent ces étiquettes qui blessent en silence.
Ces dernières années, nombre d’enfants et d’adolescents sont évalués et reçoivent un diagnostic psychiatrique: trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), trouble bipolaire, trouble de l’opposition, trouble de la personnalité borderline, etc.
Même si c’est une manière de codifier les défis d’une personne, les diagnostics psychiatriques ne sont pas toujours sans risque. Non seulement ils peuvent être erronés (erreur de perception ou biais pour médicamenter), mais ils peuvent blesser en silence la personne étiquetée sur la base de ses défis et non de ses talents…
En ce qui concerne l’autisme, les critères sont de plus en plus larges, dans le sens où il est de plus en plus facile de poser une telle étiquette. Ils sont tellement larges qu’on parle désormais du trouble du spectre de l’autisme (TSA), dont le syndrome d’Asperger représenterait le plus haut degré en termes d’autonomie sociale.
Bien sûr, les parents peuvent attendre parfois jusqu’à 18 mois – du moins au Québec – pour recevoir une confirmation officielle qui leur permettra de recevoir une aide pécuniaire et des services thérapeutiques dans le système de santé publique. Pour assurer un support scolaire adéquat, les écoles recevront également un montant jusqu’à sept fois supérieur à un élève sans difficultés académiques.

Comme pour le TDAH, il y a une volonté de dépister – de manière précoce – la présence des symptômes. C’est ainsi que des personnes travaillant dans les centre de la petite enfance et les écoles essaient de repérer des indices, mais les critères sont parfois mal interprétés. Alertés par les propos d’intervenant du monde éducatif, des parents m’expliquent régulièrement qu’on suspecte de l’autisme chez leur enfant, parce qu’il joue trop souvent avec des voitures de pompier, qu’il n’aime pas les histoires de princesse et se désorganise, qu’il parle avec un accent français (en fait, le français international) ou qu’il est, soit-disant, peu réceptif aux messages non-verbaux d’autrui.
Par ailleurs, je constate également qu’il y a une grande confusion avec les effets de la psychose (perte de contact avec la réalité) et de l’autisme. On pourrait se demander si le traitement pharmacologique n’induit pas ce biais de compréhension, puisque les anti-psychotiques – comme le Risperdal – sont fréquemment utilisés pour normaliser les comportements sociaux. De plus, les média affirment fréquemment que les tueurs de masse, comme pour les drames de Wakerton et de Dawson, ont reçu un diagnostic d’Asperger. Pourtant, « on » omet de dire que nombre de jeunes qui passent à l’acte meurtrier étaient sous médication psychostimulante et soufraient sans doute d’un trouble de la personnalité antisociale. Rien à voir avec l’autisme.
Souvent, les adultes essaient de forcer le contact. La personne affectée par de l’autisme supporte mal la pression-relationnelle et tend à se réfugier en elle-même. Elle semble peu sensible, mais l’est-elle tout simplement trop? Est-ce que le diagnostic se pose au service de la personne ou de son entourage? Est-ce qu’on perçoit la réalité de l’autre en fonction de nos attentes? Sommes-nous insensibles aux messages non-verbaux de la personne autiste? Se pourrait-il que notre orgueil pave l’enfer de bonnes intentions?
ET SI LA NEURODIVERSITÉ ÉTAIT MIEUX COMPRISE?
Psychiatre à l’Hôpital Rivières des Prairies de Montréal, Laurent Mottron est une sommité dans l’univers du traitement des enfants atteints par les différentes formes du TSA. Il s’interrogeait, il y a quelques années, sur les perceptions qu’on la plupart des individus quant à l’expérience de l’autisme. Il écrivait notamment qu’une «personne autiste douée d’une extrême intelligence et d’un intérêt pour la science, peut être une chance incroyable pour un laboratoire de recherche». Malheureusement, leurs difficultés à communiquer comme l’ensemble de la communauté fait en sorte qu’on ne réalise pas ce que ces personnes excentriques sont capables de réaliser. Leur parcours scolaire est confronté à une série de jugements de valeur et, plus tard, «les employeurs […] leurs assignent des tâches répétitives et presque serviles.»
Parfois, la perception des individus est encore plus préjudiciable, ne serait-ce qu’à cause du fait que les médias étasuniens rapportent, régulièrement, que les jeunes qui, suite à une bascule de leur esprit, deviennent des tueurs de masse étaient atteint du syndrome d’Asperger. L’influence des médias est d’ailleurs prédominante dans la perception des personnes envers un trouble ou un autre. Il y a fréquemment des amalgames. C’est normal, ce ne sont pas des spécialistes en santé mentale. Toutefois, les idées reçues font leur chemin et blessent en silence ceux qui sont suspectés d’avoir une des formes du TSA.
Pour sa part, Mélanie Ouimet (co-organisatrice du colloque à Montréal) et Josef Shovanec (conférencier) tentent de sensibiliser les différents intervenants comme l’ensemble de la société civile à la richesse de la neurodiversité. Ils dénoncent le décalage entre la perception de leur réalité et la richesse de leur neurodiversité. « La divergence des esprits humains n’est pas synonyme de déficience cognitive, mais bien de divergence cognitive » écrit Mélanie Ouimet.

En fait, les personnes suspectées d’autisme sont aussi mal comprises que les personnes atteintes d’épilepsie. Malgré toutes les apparences scientifiques et exprimées de manière politiquement correcte, beaucoup de préjugés influent sur le choix des interventions pédagogiques, voire sur leur capacité à être intégré dans une classe d’école. Lorsque je rencontre de telles situations dans ma pratique clinique, une part de mon travail va consister à démystifier et à dédramatiser les situations rencontrées par les enfants excentriques et leur famille.
CES DIAGNOSTICS QUI BLESSENT EN SILENCE
Pour faire des évaluations diagnostiques, on procède par l’usage de tests standardisés ou par le repérage d’indices comportementaux. Or, je constate que certains professionnels de la santé – dans un souci de vulgarisation de l’information spécialisée – établissent des exemples issus d’indicateurs amenant plus de confusion que d’efficacité.
Ultérieurement, l’usage de ces exemples, souvent pris hors contexte et sans tenir compte du sens d’un comportement excentrique, peut mener à la suspicion d’éventuels diagnostics qui pourrait avoir des impacts regrettables tant pour l’enfant que pour sa famille.
Un jour, les parents de Martin sont venus me rencontrer. Un membre d’équipe psychosociale avait fait passer un test de connaissance de vocabulaire et l’enfant de six ans ne connaissait pas certains mots. Par exemple, il ne savait pas ce qu’était un aspirateur. À la maison, c’est le terme de « balayeuse » qui est utilisé. Il y avait eu deux ou trois autres exemples qui étaient ressortis lors de l’entrevue avec l’enfant. Sans tenir compte de la réalité familiale, la présence d’un Asperger fut suspectée et l’éducatrice recommandait de demander au pédiatre une prescription de Risperdal, un antipsychotique fréquemment prescrit chez les personnes suspectées d’avoir une des formes du TSA. Pourtant, cet enfant était plus proche d’un comportement de BABI que d’une personne autiste, même si parfois il préférait se retrancher des pairs et jouer seul.
Durant le cheminement psychothérapeutique, des exercices psychocorporels l’aidaient à mieux nommer ses émotions et ses frustrations… Petit à petit, il arrive à mieux tempérer ses réactions, mais ce n’était pas suffisant. Ainsi, j’encourageai les parents à consulter une collègue ergothérapeute. C’est elle qui réussit, plus tard, à identifier la difficulté rencontrées par Martin.
En fait, il serait hypersensible à un grand nombre de textures. Les vêtements finissaient par induire un mal-être sans que l’enfant ne soit capable de le nommer. Pour beaucoup, c’était juste un tissu. Pour lui, c’était de l’irritation continue. À un moment, toute forme de stimuli devenait envahissant. Ayant compris l’origine des crises, l’ergothérapeute proposa une série d’exercices qui lui permettaient de se désensibiliser, alors que les parents firent attention aux textures des vêtements qu’ils lui achetaient.
À huit ans, Jacques est passionné par les camions et le monde des pompiers. Il ne s’intéresse pas aux histoires d’animaux et de fées : «c’est pour les filles et les bébés, m’explique-t-il avec un regard clair». En classe, il se retranche fréquemment et manifeste beaucoup de frustrations dès que l’on aborde des histoires si éloignées de ses passions. Son enseignante prévient alors les parents qu’elle suspecte que Jacques ait un syndrome d’Asperger. Elle mentionne notamment que l’enfant «agit comme un autre garçon qu’elle avait déjà eu en classe. Il fait des fixations vous devriez aller à l’Hôpital Sainte-Justine.»
Pour sa part, Jocelyn aimait les métiers de la ferme. Toutefois, l’équipe éducative avait relevé d’autres indices qu’on associe avec le TSA, comme Jacques d’ailleurs. Les deux garçons préfèrent jouer seuls, plutôt qu’avec les autres enfants (en thérapie, ils expliquent qu’ils n’aiment pas les disputes), ils ne regardent pas dans les yeux (ils sont timides, surtout si on tente de forcer la relation) et, surtout, ils parlent, selon l’équipe éducative, avec «un accent français», comme si parler avec un accent du français international était un indice de maladie mentale. Or, le père de Jacques est Français, alors que les parents de Jocelyn regardent fréquemment TV5 et les films européens… Et, dans les deux familles, les parents insistent pour que leurs enfants aient une prononciation la plus internationale possible.
JÉRÔME

Bien sûr, certains enfants sont affectés par des comportements autistiques. Mais, parfois, leur retrait traduit une grande sensibilité qu’ils n’arrivent pas à gérer sans se désorganiser. En effet, certains enfants, quand ils vivent de larges émotions, vont avoir le réflexe de se retirer et de cacher leurs émotions.
Contrairement à la majorité, ils ne font pas nécessairement confiance à l’adulte, ou à un ami simplement, pour vivre leurs émotions heureuses comme malheureuses. Ils sont plus sensibles à l’envahissement qu’à l’abandon. Ils s’isolent plus facilement. Cela devient parfois une habitude dont la fréquence peut inquiéter l’entourage. Et si jamais les intervenants cherchent à entrer trop brusquement en relation avec lui, sa fermeture n’a d’équivalent que la vigueur de l’impression d’envahissement. De fil en aiguille, il finit par en faire une habitude.
Quand Jérôme arrive à la clinique, c’est une collègue qui le prend en charge. Elle va passer deux ans à jouer au ballon, d’un côté à l’autre d’une longue pièce, une heure par semaine. Besoin d’espace et d’intensité par le jeu. Besoin de lien, aussi dans l’intensité. Il veut parfois attirer l’attention en touchant les seins ou les fesses de la psychologue. En accord avec les parents, la séance s’arrête immédiatement. Après deux ou trois arrêts, il comprend que pour rester en lien avec sa psy, il y a des règles. Règles qu’on installe avec les jeux de ballon.
Parfois, je viens les rejoindre. Le jeu de ballon devient plus soutenu, c’est ce qu’il aime. Un jour, il reçoit le ballon en plein visage et s’exclame : «Ah! Je comprends pourquoi les autres ne veulent pas jouer avec moi!» L’intensité le rassure, mais l’éloigne. Double contrainte qu’il apprend à mieux gérer. Il poursuit son cheminement, il se permet dorénavant de parler de ses émotions. Il apprend à nommer ses besoins. Son pédiatre explique humblement aux parents : «Il n’a jamais eu d’Asperger, cet enfant.»
Malheureusement, le retard pris par l’adolescent était tel qu’on ne pouvait pas le remettre dans un profil régulier. Sans diagnostic, il se retrouve dans une classe pour trouble du comportement. Sa sensibilité le fragilise et les comportements d’opposition augmentent. Comme la logique administrative n’avait aucune ouverture à la réalité de l’adolescent, son médecin a remis un diagnostic d’Asperger. Jérôme retourna dans une classe d’autistes.
Depuis, il a appris hors cadre scolaire un métier qui lui permet de travailler en pleine nature, sa passion. De temps en temps, il m’écrit pour m’expliquer ses réussites, son bonheur… car il en vit des émotions et il peut les manifester quand il se sent libre d’exister comme il lui semble bon pour lui-même.
Des outils pour explorer les différentes options thérapeutiques:
- Joël Monzée (dir), Neurosciences, psychothérapie et développement affectif des enfants, Éditions Liber, 2014.
- Joël Monzée (dir), Soutenir le développement affectif des enfants, Éditions Liber, 2014
- Joël Monzée, J’ai juste besoin d’être compris, Éditions Le Dauphin Blanc, 2015
- Joël Monzée, Et si on les laissait vivre, Éditions Le Dauphin Blanc, 2018.